Lecture de Neurotribus, par Steve Silberman
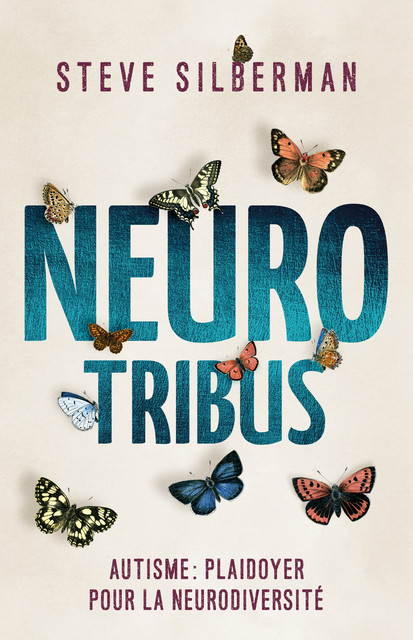
Il y a quelques années, j’ai écrit quelques articles sur les livres portant sur les adultes surdoué-es, à l’époque il y en avait une demi-douzaine en français. Depuis, d’autres livres sont parus, et les termes continuent à proliférer, sans qu’il ne semble y avoir de consensus sur la bonne terminologie : haut potentiel, précoce, surdoué, surefficient, zèbre, philo-cognitif, dyssynchrone (et je ne parle même pas de leurs avatars New Age, comme enfants indigo ou cristal)… Il faut dire que la « douance » est « paradoxale » et que l’outil de mesure pour la débusquer est supposé évaluer « l’intelligence », alors que l’intelligence n’a pas grand-chose à voir dans les « symptômes » de la douance. La bataille lexicale semble donc toujours à l’œuvre, les spécialistes ou concerné-es arguant qu’au fond, ce n’est pas une question d’intelligence. Et iels ne peuvent pas savoir à quel point iels ont raison.
Le qualificatif « surdouée » a été très utile pour moi à un moment de mon parcours. En lisant ces livres, j’avais l’impression d’ouvrir les yeux, de comprendre qui j’étais. Certes, ça ne m’a pas menée bien loin, puisque cette étiquette ne m’a donnée accès à aucun accompagnement ou outil spécifique, mais c’était rassurant de mettre un mot sur ce que j’étais. Et du coup je me suis arrêtée là. Jusqu’à ce que plusieurs années plus tard, je découvre l’autisme. Bien sûr, je connaissais déjà l’autisme, j’en avais rencontré quelques-uns dans la fiction, je savais que c’était soit des personnes qui ne parviennent pas à communiquer oralement (ou seulement difficilement) et ont des comportements répétitifs, ou alors c’est des petits génies. Je savais, ou plutôt je croyais savoir.
Et puis j’ai eu des étudiant-es qui m’ont dit qu’iels étaient autistes, au cours d’une conversation informelle ou après une crise. J’ai alors commencé à me renseigner sur le sujet, pour les comprendre et éventuellement adapter mon approche pédagogique pour celleux qui en auraient besoin à l’avenir. Et quelle n’a pas été ma surprise de découvrir que le « diagnostic » surdoué était soluble dans celui d’autisme. Par exemple, Cécile Bost relevait que les personnes surdouées avaient souvent une sensibilité supérieure à la moyenne, au niveau sensoriel. Coïncidence, les hyperesthésies (ou les hypoesthésies) sont aussi des traits autistiques. Monique de Kermadec parle longuement du « faux self » dans son ouvrage L’adulte surdoué, qui rappelle largement le terme de « masking » employé par les autistes. Intriguée, j’ai commencé à me renseigner sur les neuroatypies, et notamment sur le trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA ou TDAH). Là encore, surprise (mais en était-ce encore une à ce stade) de découvrir des parallèles entre les « traits » des surdoué-es et ceux associés au trouble de l’attention, comme la « pensée qui va trop vite » ou la peur de s’ennuyer.
En apprendre plus sur les neuroatypies, c’était comme ajouter une couche à ma compréhension de mon propre fonctionnement et celui de mes proches réputé-es « surdoué-es ». C’est comme si les caractéristiques identifiées des personnes à haut potentiel intellectuel (HPI pour les intimes) étaient les conséquences vécues par les personnes concernées des traits et mécanismes autistiques ou relatifs au trouble de l’attention. Je savais que j’avais des lubies, des fixations soudaines sur des projets ou des thématiques, et ce blog en témoigne, et il y a un nom pour ça : des hyperfixations. Je savais que j’avais du mal à parler avec des inconnu-es, et découvrir l’autisme m’a permis de comprendre que c’était lié en partie à un manque de flexibilité cognitive (c’est-à-dire la difficulté à extrapoler la bonne attitude sociale à avoir en fonction du contexte, en prenant en compte les différents paramètres). Je savais que j’avais du mal à réaliser des tâches répétitives (apprendre par cœur, faire les tâches domestiques) et découvrir le trouble de l’attention m’a permis de comprendre que ce n’était pas parce que j’avais un grocervô (cette bonne blague) mais plutôt une difficulté de régulation de l’attention. Penser mon fonctionnement en termes de neuroatypies (autisme, trouble de l’attention) plutôt qu’en termes de « douance » m’a permis de prendre davantage conscience des mécanismes qui sous-tendent mes comportements ou mes réactions, de les envisager de manière plus systémique, et aussi d’expliquer/d’éclairer davantage d’éléments qui me composent que l’étiquette « surdouée ».
Bien sûr, je ne suis pas la première à faire ce constat, qui d’ailleurs ne se limite pas à la dénonciation de la catégorisation « HPI » mais qui peut aussi inclure celle de « hyper-sensible » ou « personne hautement sensitive », catégorisation qui emprunte elle aussi des traits autistiques ou du trouble de l’attention (voir références plus bas). Et comme ces personnes qui dénoncent ces étiquettes, je suis en colère d’avoir été égarée par cette étiquette au détriment d’autres qui me semblent plus précises, plus pertinentes et surtout plus utiles, pour moi. Car être « diagnostiqué » surdoué-e, c’est s’entendre dire « pas de chance, tu es trop intelligent-e », comme une fatalité. Alors que découvrir les neuroatypies me permet d’envisager des aménagements, des thérapies ciblées, des accommodements pour que certains de ces traits soient moins handicapants pour moi. Le succès de ces étiquettes (HPI ou hypersensible) est possible du fait de la méconnaissance des neuroatypies, non seulement dans leurs spécificités (par exemple la manière dont l’autisme ou le trouble du déficit de l’attention peut se présenter différemment ou être appréhendé différemment par les professionnel-les du soin en fonction des caractéristiques de la personne, comme son sexe assigné ou sa couleur de peau, des traits autistiques plus ou moins présents ou masqués par la personne), mais aussi dans leurs fonctionnements propres (par exemple la question des co-morbidités entre autisme, trouble de l’attention , troubles dys-, etc.). Quelques ouvrages (comme Aspergirl de Rudy Simone ou A Radical Guide for Women with ADHD de Sari Solden) soulignent par exemple que l’autisme ou le trouble de l’attention se présentent différemment chez les femmes (bien qu’on puisse regretter cette appellation : il s’agit moins d’une déclinaison « au féminin » de l’autisme ou du trouble de l’attention que de formes non-stéréotypées de ces deux neuroatypies, par opposition aux formes initialement été observées chez des garçons et qui sont devenues dans les imaginaires les manifestations « typiques » de l’autisme ou du trouble de l’attention). Cette méconnaissance conduit également les individus à craindre l’un ou l’autre de ces diagnostics pour eux-mêmes ou leurs proches.
Je me souviens notamment qu’au moment de la parution du DSM-V, il y avait eu des débats concernant le choix d’une approche en termes de spectre autistique, c’est-à-dire que l’autisme n’y était plus construit selon une approche duale (autisme Kranner, les vrais autistes, et autisme Asperger, les bons autistes) mais comme un ensemble de traits, plus ou moins présents chez un individu autiste donné. Penser l’autisme comme un spectre plutôt que comme un lot de symptômes conduit à l’augmentation du nombre de diagnostics d’autisme (puisque les critères sont moins restrictifs), d’où les discours tenus par certain-es professionnel-les ou profanes que ce diagnostic n’a plus de sens puisque finalement on serait « tou-tes plus ou moins autistes » et il y aurait les « vrai-es autistes » et celleux qui auraient obtenu un diagnostic frauduleux. L’ouvrage Neurotribus, de Steve Silberman et récemment traduit en français, permet de remettre les choses en perspective et de familiariser les lecteurices français-es avec une histoire de l’autisme. Il s’agit notamment de comprendre les conditions d’élaboration et de diffusion des diagnostics d’autisme dits Kranner et Asperger, par une approche biographique des professionnel-les qui y ont contribué et des patient-es qu’iels ont rencontré, les thérapies employées, etc. Il s’agit donc de montrer ce que les diagnostics psychiatriques (et plus spécifiquement l’autisme) doivent à leurs conditions d’élaboration : état des connaissances psychiatriques, sélection des patients, convictions et enjeux personnels pour des psychiatres ou des psychologues à identifier et populariser un diagnostic, contexte social… Il rappelle également la maltraitance que subissaient (et pour certain-es subissent encore) les personnes institutionnalisées dans des établissement psychiatriques.
Steve Silberman explore ainsi les grandes questions que se sont posées les chercheureuses et les parents d’enfants autistes concernant cette condition à partir des années 1930 : l’autisme est-il héréditaire ou déclenché par une cause environnementale ? Quels sont les traits caractéristiques de l’autisme ? Quelles thérapies proposer aux personnes autistes ?
Concernant « l’origine » de l’autisme, trois hypothèses ont été avancées. La plus ancienne est celle de l’autisme comme une condition innée et transmise des parents aux enfants, formulée par Hans Asperger, qui avait observé que les parents ou proches d’enfants ou adolescents autistes présentaient des « traits embryonnaires » correspondants. Léo Kranner quant à lui estimait que l’autisme pouvait être une condition innée ou bien être provoquée par le « comportement de parents égoïstes, obsessionnels et incapables d’émotions chaleureuses ». Cette seconde hypothèse des « mères frigidaires » a été par la suite popularisée par Bruno Bettelheim (1967) et a durablement marqué les imaginaires concernant la compréhension de l’autisme. La troisième hypothèse, davantage formulée par des parents d’enfants autistes, impute l’autisme une sorte d’empoisonnement par les vaccins ou parfois à une pollution locale. Aujourd’hui, les deux dernières hypothèses sont largement discréditées par la communauté scientifique : la défaillance supposée des mères d’enfants autistes n’a jamais été basée sur des observations rigoureuses et l’association entre vaccins (ou dégagement local de produits chimiques) et augmentation (supposé) des diagnostics d’autisme tient de la concomitance plus que de la corrélation.
La grande question et qui fait aujourd’hui encore l’objet de débats est celle des traits autistiques. Steve Silberman rappelle que les catégories que nous prenons aujourd’hui pour acquises ont elles aussi une histoire, qui comporte son lot d’enquêtes, d’hésitations, de rebondissements… L’histoire commence avec Erwin Lazar, un médecin officiant dans une clinique pédiatrique de Vienne, qui s’efforce de traiter ses patient-es en mettant au point des méthodes d’enseignement adaptées aux particularités de l’enfant, afin de lui permettre de développer son potentiel. Hans Asperger rejoint ce département et avec ses collègues observe intensément, selon la méthode préconisée par Lazar, plus de 200 enfants présentant les mêmes traits caractéristiques : gêne sociale, précocité intellectuelle et fascination pour les règles, les lois et les horaires. Iels ont également rencontré des adolescent-es et adultes présentant ces traits. Asperger s’est concentré dans sa thèse sur quatre cas « prototypiques », qui ont pu donner une vision tronquée de l’autisme à ses lecteurices. Cependant, le docteur estimait que l’autisme n’était pas rare et extrêmement reconnaissable une fois qu’on sait quoi regarder. Cependant, le travail d’Asperger et de ses collègues était moins d’établir une sémiologie pour poser un diagnostic que de proposer un accompagnement adapté aux enfants concernés. À l’inverse, Kranner, spécialisé dans le traitement des « enfants inhabituels », a tenté d’identifier les caractéristiques principales du comportement de ses jeunes patient-es, qu’il identifie dans sa première publication comme une volonté d’isolement (qu’il qualifie d’incapacité de ces enfants à établir des relations de façon « normale ») et la peur du changement et de la surprise (le « désir anxieusement obsessionnel de maintien de l’uniformité »). Cette approche le conduit à enfermer ses patients dans des groupes monolithiques, ignorant les différences significatives entre eux. Or, cette approche restrictive, ses choix de sélection concernant ses patient-es et certaines de ses erreurs d’interprétation l’ont conduit à envisager l’autisme comme un trouble rare et présentant un profil similaire d’un-e patient-e à l’autre.
Kranner était un excellent observateur clinique et un écrivain persuasif, mais les erreurs d’interprétation qu’il a commises au sujet du comportement de ses patients ont eu des retombées considérables. En blâmant les parents et en les déclarant involontairement responsables de l’autisme de lerus enfants, Kranner a fait de son syndrome une source de honte et de stigmatisation pour des familles du monde entier tout en engageant la recherche sur l’autisme dans la mauvaise direction pour des décennies. (p. 192)
L’approche plus extensive de l’autisme, proche de celle d’Asperger, sera remise au goût du jour par une psychiatre britannique et mère d’une fille autiste, Lorna Wing, qui remet en cause la validité empirique des critères de Kranner dans les années 1970. Au cours d’une recherche sur les comportements autistiques d’enfants diagnostiqués comme souffrant de déficience intellectuelle, Wing et sa collaboratrice Judith Gould ont constaté que certains enfants présentent des caractéristiques rappelant le syndrome de Kranner, mais qui ne peuvent être diagnostiqués comme tels si on suit son approche restrictive. Dès lors, Wing milite auprès de ses collègues pour faire reconnaitre l’autisme comme un diagnostic dimensionnel plutôt que catégoriel (la question n’est pas « s’agit-il ou non de ce trouble ? » mais plutôt « de quel sous-type on parle ? ») et propose le terme de « continuum de l’autisme », puis de « spectre de l’autisme », expression qui va finir par s’imposer. Elle propose également l’appellation de « syndrome d’Asperger » pour éviter la stigmatisation associée au mot « d’autisme ».
Cette approche de l’autisme va s’imposer dans le DSM V, qui avait anciennement qualifié ce syndrome de « réaction schizophrénique de type infantile » (DSM I, 1952), puis de « schizophrénie de type infantile » (DSM II, 1968), puis « d’autisme infantile » (DSM III, 1980) conforme au travail de Kranner, rebaptisé « trouble autistique » dans la version révisée (1987). Cette version révisée remplace la liste de contrôle stricte (l’enfant doit présenter l’ensemble des critères pour être diagnostiqué) par un ensemble d’options (la personne doit remplir un certain nombre de critères dans la liste pour être diagnostiquée), ce qui conduit à une hausse du nombre de diagnostics, proportion qui croit encore lors de la parution du DSM IV, assortie d’outils de diagnostics (ADOS, ADI). Les révisions apportées au DSM V (2013) prolongent ces transformations, puisque le syndrome d’Asperger n’y apparait plus comme une catégorie à part, au profit d’une catégorie « trouble du spectre autistique », composé d’un ensemble de traits dont le diagnosticien ou la diagnosticienne mesure la sévérité.
Cette augmentation du nombre de diagnostics semblait inévitable aux deux chercheuses à l’origine de ce changement, puisqu’il s’agissait justement de permettre à des familles dont les enfants ne rentraient pas la définition étroite du syndrome défini par Kranner de bénéficier d’aides eux aussi.
Pour Lorna, le floutage des limites entre l’autisme et l’excentricité a aussi contribué, de façon inévitable, à la perception répandue que le trouble était en augmentation. Après avoir élaboré le concept du syndrome d’Asperger, Lorna et Judith ont commencé à remarquer que les caractéristiques associées étaient courantes chez les gens qui les entouraient, en particulier dans les familles d’enfants amenés au centre pour être évalués et chez les professeurs de domaines techniques. « De toute évidence, il est très difficile de fixer la limite entre les syndromes de Kranner et d’Asperger, expliquait Lorna, mais aussi entre Asperger et la normalité. (p. 431)
L’ouvrage se termine avec la publication de témoignages d’adultes autistes (comme celui de Temple Grandin) et l’émergence de communautés autistiques, qui ont par exemple forgé les termes « neurodiversité » ou « neuroatypique » pour dépathologiser la conception de l’autisme et concevoir cette condition comme une différence et non comme une maladie. Une grande partie de ces communautés remettent aujourd’hui en cause une appréhension de l’autisme en termes « d’étiquette de fonctionnement », c’est-à-dire les distinctions faites entre autistes « à haut niveau de fonctionnement » ou à « bas niveau de fonctionnement », ou entre autistes Asperger et Kranner, car elles créeraient des divisions artificielles entre les personnes situées sur le spectre de l’autisme et contribueraient à une vision unidimensionnelle de l’autisme (du plus au moins) plutôt qu’une approche pluridimensionnelle.

Concernant les thérapies envisagées pour les personnes autistes, elles dépendent largement de la conception de l’autisme par les thérapeutes supposé-es. Ainsi, comme exposé plus haut, l’approche d’Asperger promouvait le développement d’une relation de confiance entre l’enfant autiste et son professeur et la réalisation du potentiel du premier. Il ne s’agit donc pas de faire disparaitre les traits autistiques de ces enfants, mais de développer leurs points forts. Telle n’est pas l’approche d’Ole Ivar Løvaas qui dans les années 1960 décide de prolonger des recherches menées par des behavioristes sur le conditionnement d’enfants ayant un retard de langage. L’hypothèse de départ était que si on apprend par un système de punitions/récompenses aux enfants autistes à ne plus pratiquer des comportements d’autostimulation ou d’écholalie et la maitrise du langage oral, on pourra rendre ces enfants « normaux ». La méthode ABA (applied behavior analysis) ou l’analyse appliquée au comportement a été largement critiquée, tant pour les moyens employés que pour son manque d’efficacité ou pour les présupposés sur lesquelles la méthode repose. En effet, imposer aux enfants des choses qui les mettent mal à l’aise ou leur sont insupportables, comme des étreintes, de manière systématique et répétée soulève déjà des questions éthiques ; mais lorsqu’on sait que certaines expériences de Løvaas impliquaient des punitions comme des sons à plus de 100 décibels ou des chocs électriques, on peut difficilement justifier ce genre de tortures. On peut également se demander quels progrès peuvent être réalisés par les enfants soumis à cette méthode : on peut supposer que ces programmes de conditionnement apprennent à avoir une réponse spécifique dans un contexte spécifique, apprentissage réalisé dans la peur et la détresse, mais pas à développer des compétences sociales (ou autres) réelles et applicables dans la multiplicité des contextes sociaux possibles. Enfin, cette méthode est également critiquée parce qu’elle repose sur l’hypothèse que les comportements autistiques comme l’autostimulation sont le signe d’un dysfonctionnement et qu’il faut les faire disparaître, alors qu’ils jouent un rôle dans la capacité des personnes autistes à réguler leurs émotions, communiquer avec leur environnement, à se concentrer, etc. Enfin, en partie sous l’influence de la perception de l’autisme comme la conséquence d’un « empoisonnement », des méthodes de « traitement » supposé de l’autisme se sont développées, en se basant par exemple sur des compléments alimentaires mais aussi sur des procédés plus invasifs comme la chélation.
Que retenir de tout ça ? Certainement pas que les personnes autistes sont intrinsèquement surdouées. Mon hypothèse concernant l’apparente concomitance entre les traits autistiques et ceux attribués aux personnes ayant obtenu des scores élevés aux tests de QI pourraient tenir à la forme même de ces tests, qui mesurent des compétences logiques ou des connaissances de culture générale qui pourraient être supérieures à la moyenne en raison du mode de traitement de l’information des personnes autistes ou de leurs intérêts spécifiques par exemple. Peut-être que cela tient à des biais de sélection des personnes qui passent ou obtiennent des scores élevés aux tests de QI. Dans tous les cas, l’intelligence est un terme flou qui désigne en réalité une pluralité de compétences et de capacités difficilement mesurables, et n’est de toute façon pas très intéressante pour rendre compte des spécificités des individus. Les partisan-es du « diagnostic » de douance ont toujours affirmé que ce n’était pas une question d’intelligence :
Avoir un QI élevé, ce n’est pas tellement être quantitativement plus intelligent que les autres, mais surtout avoir un fonctionnement qualitativement très différent au niveau intellectuel. (Jeanne Siaud-Facchin, source)
Je ne peux que leur donner raison. Neurotribus, dans un récit imagé et vivant, met en évidence que la compréhension de l’autisme n’est qu’à ses débuts, dans un processus de tâtonnement qui tient beaucoup aux catégorisations employées et surtout au caractère restrictif ou extensif des critères d’identification. Espérons que les apports de l’approche en termes de neurodiversité continueront à se diffuser dans les milieux thérapeutiques et auprès du grand public, afin de proposer des soins fondés sur les besoins des individus plutôt que sur des « conditions » et de permettre une plus grande acceptation des spécificités de chacun-e.
Note : Asperger et le nazisme
Dans Neurotribus, Steve Silberman explique que s’il est certain qu’Hans Asperger a dû prêter allégeance à Hitler sans quoi il n’aurait pas conservé son poste à l’université, et qu’il a participé à une conférence devant un public nazi, il n’y avait pas de preuve plus explicite qu’il ait collaboré plus avant avec le régime nazi. Une nouvelle publication plus récente de l’historienne Edith Sheffer Les enfants d’Asperger et l’historien de la médecine Herwig Czech ont quant à elleux mis en avant des indices et des preuves qui dépeignent au contraire Asperger en adhérant à l’idéologie nazi. Steve Silberman s’est par la suite exprimé sur ces découvertes dans une interview avec Maxfield Sparrow.
Note : lire Neurotribus
L’ouvrage est évidemment bien plus complet que le bref résumé que j’en ai fait ici. Il laisse une large place à des portraits de personnes autistes, qu’elles soient ingénieures, scientifiques ou patientes des différents professionnel-les de santé évoqués. Les faits rapportés sont parfois d’une grande violence, mentale et physique [TW : torture, violences psychiatriques, auto-mutilation, maltraitance].
Sources sur l’autisme
Ouvrages de synthèse
Le syndrome d’Asperger de Tony Attwood
Le trouble du spectre de l’autisme dirigé par Nathalie Poirier et Catherine des Rivières-Pigeon
Aspergirl de Rudy Simone
Spectrum Women de Barb Cook et Michelle Garnett (anglais)
Recommandations de Tribulations d’une Aspergirl
Témoignages
In my own language d’Amanda Baggs (sous-titres français)
La différence invisible de Julie Dachez et Mademoiselle Caroline
Autos de Laura Esculape
Pourquoi pas autrement
Recommandations de lecture par Dcaius
Vulgarisation
Alistair
Dcaius
Amythest Schaber (anglais)
Histoire de l’autisme
Critères de diagnostic du DSM V (anglais)
Autisme « féminin » ou autisme tout court ?
Critique des catégories « hypersensible » ou « surdoué »
- vidéo d’Alistair
- thread Twitter d’Angie Breshka
- article de Turlupitudes
- vidéo d’Angie Bershka
- thread d’Alistair
- thread de Mae
- thread de The Unsoft
- Publié dans: Choses lues♦Neuroatypie
- Tagué:Asperger, autisme, autiste, bilan de lecture, compte-rendu de lecture, Douance, DSM, enfant intellectuellement précoce, enfant surdoué, haut potentiel, hpi, Kranner, lecture, méthode ABA, neuroatypisme, neurodiversité, neurotribus, note de lecture, philo-cognitif, résumé, spectre autistique, spectre de l'autisme, Steve Silberman, surdoué, surefficience, surefficient, TSA, zèbre
1 commentaire
Rétroliens